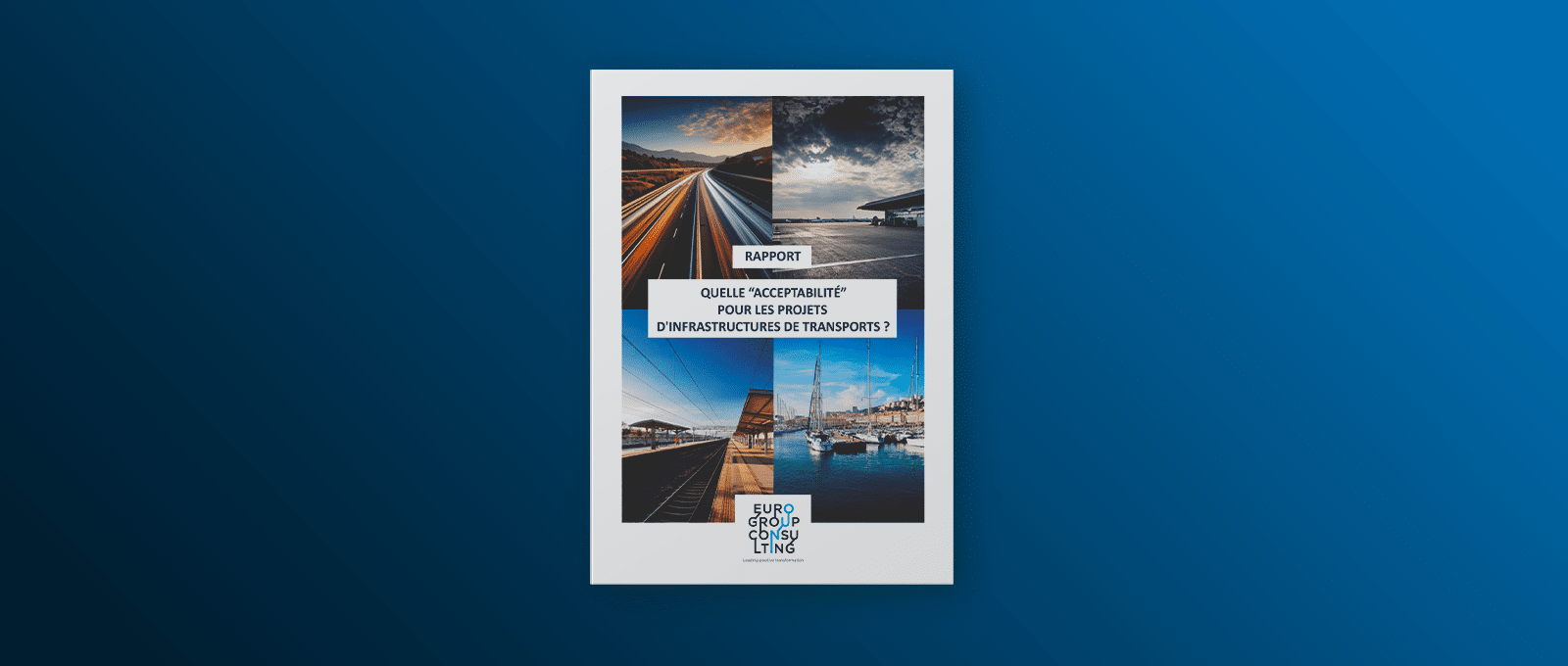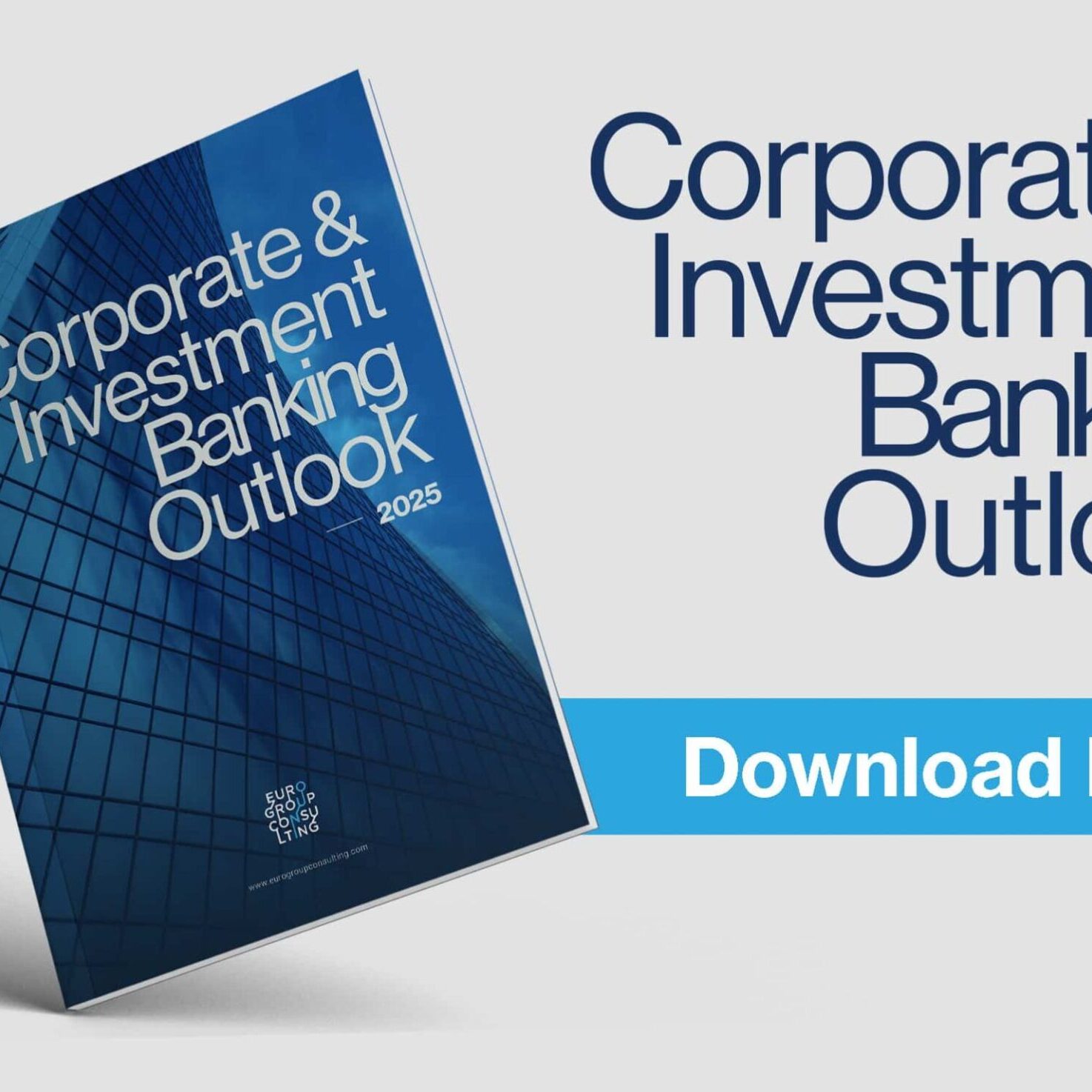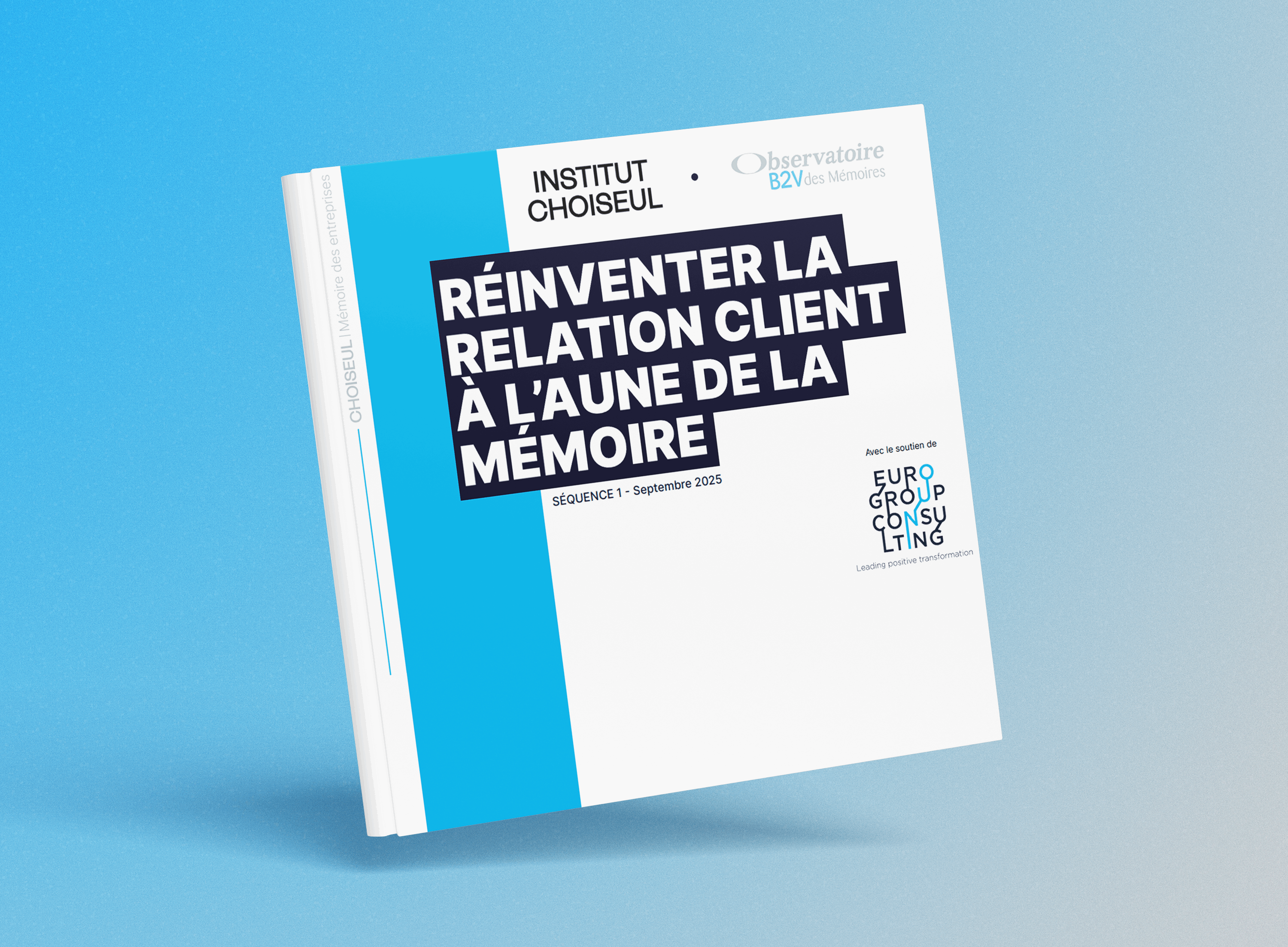Qu’il s’agisse des infrastructures de transports ou d’urbanisme, « l’acceptabilité » des projets pose de plus en plus question.
Entre impératifs d’intérêt général et préoccupations locales, comment concilier vision stratégique et concertation démocratique ? Quels leviers pour renforcer la confiance ? Quels outils pour mieux associer les territoires et leurs habitants ? Et comment repenser la gouvernance des grands aménagements à l’heure des grandes transitions ?
Nos expertes Clémence Cazemajour, Aurélie Schraub et Cécile Gouesse vous proposent de découvrir les réponses à ces enjeux dans leur rapport disponible au téléchargement !
Téléchargez la note de réflexion
Pour télécharger le fichier, veuillez remplir le formulaire
Une problématique au cœur des débats
Alors que « l’acceptabilité » des projets a été largement débattue lors de la conférence France Transport qui s’est tenue de mai à juillet 2025 et alors que Clément Beaune, Haut-commissaire à la stratégie et au plan, a missionné en juin 2025 le préfet Cadot pour mener un « travail de réflexion sur les leviers d’action juridiques et administratifs permettant d’élaborer un cadre renouvelé pour la réalisation de projets d’infrastructures dans notre pays » , le présent rapport dresse un panorama des enjeux et pratiques des gestionnaires d’infrastructures de transport (aéroports, ports, ferré, routes) en la matière, ainsi que des pistes d’actions pour mieux coconstruire les projets d’infrastructures.
Un contexte de plus en plus complexe
Les projets d’infrastructures de transport en France évoluent dans un contexte de plus en plus contraint et complexe : cadre financier et budgétaire contraint, cadre règlementaire de la transition écologique (bas carbone, zéro artificialisation nette, etc.), mais aussi articulation aux projets de territoire, et meilleure association des parties prenantes, au-delà du recours à la concertation qui s’est désormais installé. Dans le même temps, une large majorité de Français réaffirment leurs attentes en matière d’investissements dans les infrastructures de transports (avec des scores de 70 % à 94 % selon les types d’infrastructures).

Des difficultés croissantes pour mener les projets
Plusieurs évolutions accentuent la difficulté à mener les projets :
- La multiplication des recours juridiques et des procédures administratives : il y aurait par exemple près d’une soixantaine de projets routiers et autoroutiers faisant l’objet de contestations en France en 2024 ;
- La difficulté à projeter ces infrastructures dans un avenir partagé ;
- Enfin, depuis les années 2010, la montée des mobilisations d’oppositions locales (Notre-Dame-des-Landes, A69, LGV Sud-Ouest, etc.)
En comparaison avec le cadre règlementaire de la concertation en France, l’Allemagne privilégie une construction itérative de la légitimité, dans un contexte où dans un pays fédéral, chaque niveau de gouvernement détient une légitimité propre. Les régions, Länder et communes attendent d’être pleinement associés aux décisions impactant leur territoire. Cette architecture politique impose des coordinations longues et complexes, mais elle garantit que les projets soient perçus comme « co-construits » plutôt qu’imposés. transports transports transports transports trasnports
Comment mieux « fabriquer » les projets d’infrastructures ?
Les experts interrogés partagent plusieurs bonnes pratiques :
- Associer l’ensemble des parties prenantes : citoyens, élus, associations, acteurs socio-économiques, État ;
- Prendre le temps de la concertation : assez tôt pour être crédible, mais pas trop tôt pour que les options soient suffisamment précises pour être discutables ;
- « Donner matière à concerter » : ouvrir un projet à la discussion en identifiant ce qui, concrètement, peut encore évoluer ;
- Responsabiliser les politiques et les financeurs décideurs, dans leur capacité à assumer leur rôle dans la décision et dans la pédagogie du projet ;
- Distinguer (porteur de) projet et gestionnaire d’infrastructures, éviter l’amalgame entre la maîtrise d’ouvrage politique du projet (qui définit les objectifs, les bénéfices attendus et les arbitrages) et la maîtrise d’œuvre technique / gestionnaire d’infrastructure (qui met en œuvre les solutions concrètes)

Au-delà de mieux « fabriquer » les projets d’infrastructures, comment faire autrement, renouveler le cadre d’intégration des projets aux territoires ? Dans ce rapport, plusieurs pistes sont identifiées :
- Engager autrement autour des projets d’infrastructures : mobiliser des influenceurs dédiés aux projets, utiliser la facilitation graphique, multiplier et adapter les dispositifs pour engager le territoire, voire développer les référendums locaux sur les projets d’infrastructure ;
- Dialoguer à partir de projets de territoires, et non plus de projets unitaires : inscrire la concertation dans une logique multi projets au sein d’un territoire ;
- S’attacher à la mémoire des projets (et des territoires) : bien connaitre son territoire, les besoins, les enjeux à travers des études de contexte, tracer tous les engagements et concessions pris sur le projet ;
- Travailler la complexité procédurale et administrative : regrouper les autorisations, développer les gouvernances unifiées État / collectivités, recourir à et valoriser la concertation volontaire anticipée ;
- Revoir les logiques d’association / dédommagements des acteurs : homologuer des transactions entre le maître d’ouvrage et les associations, ouvrir la possibilité pour le maître d’ouvrage d’avenanter les marchés publics sur la base de la DUP ou de la déclaration initiale, sans devoir relancer toute la procédure, encourager des dispositifs de médiation obligatoires en amont ou autour de la DUP pour anticiper les oppositions et co-construire des compromis légitimes, et publicisés.
NOS EXPERTS