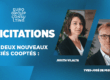Les récents propos du Chef d’Etat-Major des Armées lors du Congrès des Maires, malgré les polémiques qu’ils ont suscitées, ont rappelé une évidence stratégique : un conflit de haute intensité affecterait l’ensemble de la Nation et non plus les seules forces armées.
Les conflits menés par les armées françaises depuis les années 2000 ont principalement relevé de la lutte contre le terrorisme ou d’opérations de maintien ou rétablissement de la paix. À ce titre, elles n’ont pas eu pour enjeux directs la survie de la Nation et la préservation de sa souveraineté.
Or, le retour de conflits majeurs du type de celui en cours en Ukraine rappelle que la guerre engage la Nation dans toute sa profondeur : administrations, entreprises, corps intermédiaires, collectivités, citoyens. Expression collective de la volonté clausewitzienne, la Nation contribue à l’effort de guerre par l’action directe sur les théâtres d’opération, par le soutien logistique et technique aux unités engagées, mais aussi par la continuité des activités essentielles à la vie du pays.
C’est en partie le rôle dévolu aux réservistes. En cas de crise ou de guerre, la réserve permet de mobiliser des ressources complémentaires, qu’elles soient opérationnelles, industrielles ou techniques. Avec le renforcement des tensions internationales, le ministère des Armées a engagé un effort important d’extension de ces dispositifs, avec l’objectif d’atteindre, à terme, un réserviste pour trois militaires d’active.
Un autre enseignement des conflits contemporains, avec l’accélération des rythmes qu’ils emportent, porte sur le fait que la supériorité opérationnelle ne dépend plus uniquement de la capacité d’engagement mais également de la rapidité d’intégration de l’innovation. D’où la nécessité de repenser la place de la société civile dans le dispositif global d’innovation de défense. innovation défense innovation défense
Un rôle majeur joué par la société civile dans le cadre du conflit en Ukraine
L’exemple ukrainien illustre l’apport déterminant de la société civile. Sous la pression d’un conflit existentiel, des milliers d’acteurs non militaires ont conçu, adapté et déployé, aux côtés des forces armées, des solutions technologiques, tactiques ou organisationnelles immédiatement utilisables. Cette dynamique ne relève pas de l’improvisation. Elle repose sur un processus continu enclenché depuis l’invasion de la Crimée en 2014 par la Russie, qui a constitué un véritable électrochoc et réactivé la mobilisation citoyenne. Face à un État limité, et à des forces armées éparses (elles n’étaient constituées que de 260 000 hommes en 2021 contre près de 900 000 aujourd’hui), la société ukrainienne a développé un socle technique, social et entrepreneurial, capable de basculer rapidement au service de la défense.
Sur le terrain, l’accélération significative du rythme de l’innovation de défense et la vitesse d’évolution des besoins opérationnels rendent particulièrement difficile de prévoir les capacités nécessaires en cours d’opération. Or le monde civil, même lorsqu’il est éloigné des problématiques de défense, dispose de compétences massives et diversifiées (cybersécurité, robotique, IA, ingénierie logicielle, fabrication additive, électronique, matériaux avancés), susceptibles de contribuer à répondre à ces nouveaux besoins. Les ingénieurs roboticiens travaillant pour l’industrie, les experts en cybersécurité évoluant dans le secteur privé ou les entrepreneurs spécialisés dans les drones n’appartiennent pas toujours aux réseaux de défense, alors même qu’ils détiennent des capacités immédiatement valorisables.
Vers la mise en place d’un dispositif de type « réserve d’innovation » complémentaire aux dispositifs de réserve existant
La constitution d’un dispositif de réserve d’innovation permettrait :
- D’identifier, en temps de paix, les personnes et organisations susceptibles d’apporter un appui en temps de crise, et de cartographier leurs compétences ;
- De devenir un point d’entrée structuré pour capter les idées d’innovation, qu’elles soient technologiques ou organisationnelles ;
- De faciliter la diffusion rapide des solutions en mettant en relation innovateurs, bénéficiaires potentiels et communautés techniques. Le cas ukrainien en fournit des preuves concrètes : l’unité Aerorozvidka, née de la coopération entre experts civils du drone, ingénieurs logiciels et militaires, a contribué au développement de Delta, un système de situation tactique aujourd’hui central ; la production improvisée de munitions pour drones FPV par des entrepreneurs locaux a permis des adaptations rapides sans dépendre de cycles industriels longs ; les réseaux de développeurs de l’IT Army ont apporté une capacité de défense cyber distribuée et réactive ;
- De participer à la diffusion de l’esprit de défense, en facilitant en cas de crise l’activation d’autres dispositifs citoyens comme le montrent les exemples de fundraising en Ukraine ou l’animation par certaines organisations de formations gratuites pour adopter les bons gestes réflexes en cas situation d’urgence (quel numéro appeler, quelle fréquence radio écouter, quelles réserves de nourriture et de matériel stocker chez soi, etc.).
Deux principes doivent guider la conception d’un tel dispositif :
- La simplicité. Le dispositif doit être accessible, aligné sur les usages civils et adossé à des outils existants. Il ne doit pas nécessairement se traduire par un engagement contractuel au sens des réserves actuelle. La crise impose en effet de préserver la souplesse des liens entre forces armées et population. L’enjeu pour le ministère des Armées serait ainsi de créer un cadre permettant de canaliser l’intelligence collective nationale en s’affranchissant du lien organique que représente le contrat d’engagement, dans les forces d’active ou dans la réserve actuelle. L’expérience ukrainienne montre d’ailleurs que des plateformes civiles, comme Kickstarter ou Gofundme, peuvent devenir des vecteurs de soutien et d’identification d’innovations issues de la société civile. C’est d’ailleurs ce type de plateformes qui a, pour partie, inspiré l’initiative « Brave1 » mise en place par le ministère de la défense ukrainien pour rassembler entreprises, citoyens et militaires autour de projets à potentiel opérationnel.
- L’anticipation. La rapidité d’action étant un facteur décisif lors d’un conflit, le dispositif doit être structuré en amont pour être activable immédiatement en cas de crise. Cela suppose d’ouvrir dès à présent plusieurs chantiers : modalités de recensement des compétences mobilisables, architecture fonctionnelle du dispositif, articulation avec les réseaux existants, stratégie de communication et de sensibilisation.
La mobilisation de la société civile pour l’innovation de défense s’inscrit dans un mouvement plus large : celui de l’émergence progressive d’un concept français de « défense totale », inspiré des modèles scandinaves et ravivé par les enseignements de la guerre en Ukraine.
Une réserve d’innovation agile, préconfigurée et interconnectée pourrait devenir l’un de ses piliers, en permettant de transformer rapidement des compétences civiles en capacités militaires opérationnelles, et en constituant ainsi un avantage stratégique sur les théâtres d’opération.
NOS EXPERTS

Michaël AGBOHOUTO
Associé

Adeline
TARAVELLA
Directrice Associée