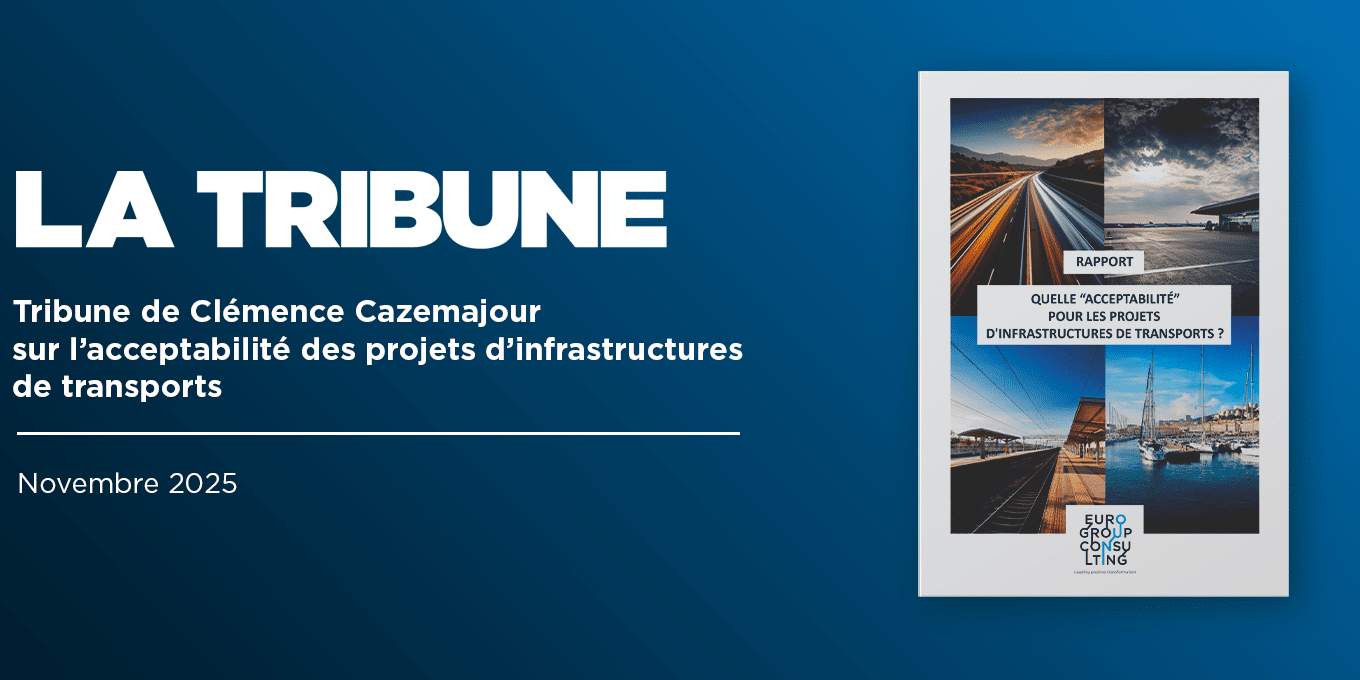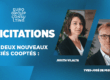À quelques heures de la clôture du Salon des Maires, le sujet de l’acceptabilité des grands projets d’infrastructures revient au premier plan. Non pas comme un débat technique, mais comme une question stratégique pour les territoires.
Les élus arrivent avec une même préoccupation : comment continuer à investir alors que les projets se heurtent à une contestation plus structurée et des procédures toujours plus denses ?
Dans ce contexte, l’acceptabilité n’est plus un « enjeu périphérique » des infrastructures : elle en est devenue la condition de réalisation. Si la France veut maintenir sa compétitivité territoriale, elle doit résoudre ce point de friction majeur entre volonté d’investissement et capacité réelle à faire aboutir les projets.

« Fabriquer » autrement les projets d’infrastructures est indispensable si l’on veut préserver notre capacité à mener les projets structurants dont dépend la compétitivité du pays.
- Premier constat : la concertation intervient souvent tard. Lorsque le dialogue s’ouvre, les marges d’évolution sont déjà extrêmement limitées, ce qui nourrit l’impression d’un processus figé. L’exemple de l’A69 l’a illustré : quand les choix structurants ne peuvent plus être réinterrogés, la contestation se déplace vers les symboles ou les procédures, au détriment du débat de fond.
- Deuxième constat : la difficulté à donner du sens aux projets. Une infrastructure, au-delà de sa performance technique doit s’inscrire dans un avenir crédible : transition écologique, capacité d’adaptation, cohérence territoriale. Sans récit partagé, un projet d’infrastructure apparaît comme une réponse technique déconnectée d’une vision collective.
- Troisième constat : la montée en puissance d’acteurs locaux plus structurés. Associations environnementales, collectifs d’usagers, riverains organisés… tous produisent diagnostics, contre-propositions et analyses d’usage. Ils sont devenus des acteurs légitimes du débat. Mieux reconnaître ces acteurs, notamment en s’appuyant sur le maire comme « intercesseur » entre les projets d’infrastructures et les citoyens, c’est aussi sécuriser l’acceptabilité sociale.
La fabrique des projets doit donc évoluer. Et c’est en intégrant pleinement cette nouvelle réalité territoriale que l’on peut retrouver des marges de manœuvre. Les grands projets demeurent possibles si l’on change de méthode et si l’on assume un véritable choix politique en faveur de l’investissement territorial.
- D’abord, inscrire les infrastructures dans des trajectoires territoriales plutôt que les présenter comme des objets isolés. Le Grand Paris Express en est une illustration : articulé à l’aménagement, à l’emploi et à l’environnement, il bénéficie d’un consensus plus stable et d’une mobilisation soutenue des collectivités. C’est en montrant clairement ce que transforme un projet (et pour qui) que l’on renforce son acceptabilité.
- Ensuite, donner une vraie matière au dialogue. Clarifier ce qui peut évoluer, expliquer ce qui ne le peut pas, documenter les ajustements : ces éléments renforcent la confiance. La Ligne Nouvelle Paris–Normandie montre l’inverse : les évolutions successives, peu explicitées, ont brouillé la compréhension du public et fragilisé l’ancrage du projet. La transparence devient ici un levier stratégique, pas un simple exercice réglementaire.
- Autre piste : traiter la complexité procédurale. Regrouper davantage d’autorisations autour de la DUP, recourir à la médiation encadrée ou permettre des transactions homologuées entre maîtres d’ouvrage et associations peuvent réduire les contentieux tardifs et sécuriser le calendrier, sans affaiblir le débat démocratique.
Oui, les grands projets d’infrastructures sont encore possibles en France. Leur réussite dépend désormais autant de la qualité du dialogue que de la qualité de l’ingénierie. Mieux fabriquer les projets, c’est conjuguer souveraineté, ancrage territorial et lisibilité de l’action publique. C’est aussi choisir collectivement de donner aux territoires les infrastructures dont dépend notre compétitivité future.
Cette tribune a été publiée dans La Tribune par Clémence Cazemajour, le 20 novembre 2025.
EN SAVOIR PLUS