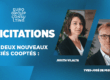Donner le pouvoir : obsession du management des services
Une des bonnes pratiques mises en évidence depuis qu’on cherche les principes d’un bon management des services, se cristallise dans un mot : empowerment. En français, donner du pouvoir. À qui ? Aux acteurs au contact du client, ceux qui se trouvent en bas de l’organigramme et sont dotés de peu de pouvoir hiérarchique.
Dans les cas – fréquents – où il faut réconcilier les process de l’organisation et les attentes et capacités des clients, étendre l’autonomie décisionnelle jusqu’à l’échelon le plus bas de l’organisation, c’est se permettre d’éviter la rengaine : “passez-moi votre responsable !” C’est lors de ces moments où se joue la réussite de la prestation de service, que Jan Carlzon appelait les “moments de vérité”, qu’un responsable ressentira probablement la nécessité de donner les clés de l’organisation à ses collaborateurs.
L’ex PDG de Scandinavian Airlines System (SAS) en tirait d’ailleurs les conséquences en appelant à inverser fondamentalement les rapports de pouvoir dans l’organisation de service : “If you’re not serving the customer, your job is to be serving someone who is.” Au personnel au contact la responsabilité (le devoir !) de satisfaire le client, et au management la responsabilité (le devoir !) de servir les employés de telle façon qu’ils puissent assurer la satisfaction du client.
L’empowerment, c’est donc la garantie d’être plus orienté client, d’être plus réactif et plus flexible, c’est enthousiasmant et valorisant pour les collaborateurs… une évidence ?
Vers une totale autonomie ?
Les évolutions de l’économie des services plaident à vrai dire en ce sens. Le développement de l’économie collaborative donne l’opportunité à tout un chacun de proposer ses services et de valoriser ses ressources (sa voiture, ses compétences de bricolage…). La lame de fond que constitue l’ubérisation de la société en est le symptôme le plus évident. Si l’on se fie aux campagnes de recrutement d’Uber à destination des potentiels conducteurs, la promesse de l’autonomie associée à l’entrepreneuriat est claire et séduisante : « soyez votre propre boss” !
Cet avènement d’une ère d’autonomie ne va pas cela dit sans frottements ! La contestation a une autre face, celle des procès à répétition qui repose précisément sur une contestation par les travailleurs de l’autonomie qui leur était promise (et la demande de reconnaissance de leur subordination), eux qui doivent suivre au doigt et à l’œil les instructions de l’algorithme. L’autonomie n’est donc parfois que de façade – à minima elle est partielle !
La limite de l’autonomie et le besoin de contrôle ne doivent pas nous surprendre. Encore moins dans les services de masse, où ils constituent une tension fondamentale – bien mise en évidence par Marek Korczysnski à travers son concept de bureaucratie orientée-client. D’après ce sociologue anglais, il s’agit d’une organisation qui essaie de s’adapter à la diversité des clients tout en maintenant des process standards. La formule sacrée de McDonald’s “we want to treat each customer as an individual in sixty seconds or less” témoigne bien de la tension structurelle entre flexibilité et standardisation. Cette tension n’empêche pas que la question de la responsabilisation et de la latitude décisionnelle des collaborateurs se pose, et qu’il s’agit de comprendre à quelles conditions on peut en assurer la réussite.
Les vraies conditions d’un empowerment réussi
Alors, comment réussir l‘autonomisation des acteurs de la relation de service ? Comment faire en sorte de bien concilier autonomie et contrôle, pour éviter de mauvaises surprises ? Ce qui est certain, c’est que l’autonomie ne se décrète pas. Et nous savons bien que beaucoup de professionnels qui nous lisent ont, au moins une fois dans leur vie professionnelle, tenté de donner le pouvoir à leurs équipes, sans que cela soit suivi des effets ou des résultats espérés. À partir de notre connaissance de la littérature et de nos retours d’expérience terrain, nous voyons trois conditions principales à réaliser.
Premièrement, il faut s’assurer d’un cadre commun de sens au niveau de l’organisation. Autrement dit, il faut faire en sorte qu’au sein de l’organisation, une culture orientée vers le service du client soit partagée. Cette culture signale aux collaborateurs l’importance de satisfaire le client, et donc permet de leur donner la confiance nécessaire pour passer plus de temps qu’habituellement (ou que prévu par le standard) avec un client au besoin spécifique, ou pour décider d’ignorer une règle (exemple : un client connu à qui on ne demande pas de présenter de nouveau sa carte).
Le cadre commun de sens peut se traduire également par ce que les spécialistes du management des services appellent un “climat de service”,
autrement dit la perception par les collaborateurs que tout dans l’organisation va dans le sens du service (les règles et standards, mais aussi les politiques RH et l’aménagement des espaces !).
Le second principe, c’est de faire en sorte que les acteurs soient équipés en conséquence de leur autonomie. Ici, on réfléchit au niveau du poste de travail, en examinant de façon critique le travail quotidien. Il n’est pas rare que des directions décident de responsabiliser les acteurs de terrain (peut-être en toute sincérité), mais sans s’être assurés des conditions réelles de réalisation des missions et tâches confiées. Les ressources en question peuvent être un outil (une fiche client donnant les informations nécessaires pour prendre une décision pertinente), une latitude décisionnelle formelle (le logiciel permettant effectivement de modifier le plafond de remboursement), du temps (le staffing étant suffisant pour prendre le temps avec un client sans générer une longue file d’attente), ou aussi le développement de compétences – comme Starbucks créant un programme de formation de “coffee master” pour que l‘expertise de ses employés leur permette de prendre des décisions quant à la personnalisation des boissons. Les développements technologiques passés et actuels ont offert de nouvelles possibilités pour enrichir l’équipement des agents : applications métiers type CRM offrant des ressources (par exemple des réponses types), ou plus récemment les agents conversationnels IA qui débriefent les agents sur l’interaction qui vient de s’achever et anticipent les prochaines étapes. On le perçoit bien avec ces exemples, les règles métiers définies lors de projets de déploiement d’outils de GRC, Marketing ou de Vente peuvent tout autant soutenir et révéler l’orientation client du collaborateur que l’affaiblir irrémédiablement.
La question pour les décideurs n’est donc pas seulement de savoir si l’organisation dispose ou non d’un outil, mais de savoir si cet outil et les processus associés soutiennent l’autonomie et l’excellence de service … ou non. .
Enfin, le dernier principe se joue au niveau des individus. Pour un même poste occupé au plus près du client, en effet, il y a une variabilité des personnes qui occupent ces postes. Chaque collaborateur a une personnalité propre et s’inscrit dans une trajectoire singulière, conditionnant un rapport au travail qui favorisera plus ou moins le désir d’autonomie, la capacité à assumer les conséquences de sa propre responsabilité, la volonté de satisfaire le client, et la confiance en ses propres capacités. Comme les acteurs peuvent le dire parfois avec leurs mots, une relation de service, “c’est très personnel”. Il y a ainsi des collaborateurs qui seront à l’aise avec le fait de décider de la marche à suivre en gardant en tête l’ambition finale de satisfaire le client, et d’autre qui auront besoin de se raccrocher à une règle ou une politique client pour savoir comment réagir. Faire en sorte que chaque personne soit en phase avec une démarche d’empowerment, cela passe ainsi par un accompagnement RH et managérial – sur un temps long parfois, celui de l’évolution personnelle. Cela passe aussi par les interactions avec les pairs, qui vont permettre à chaque collaborateur de trouver et de s’approprier une pratique de travail qui lui convient. Ces évolutions individuelles, soutenues par le management et les collectifs de travail, soutiennent le développement d’une culture de service.
Cet article s’inscrit dans une série de publications consacrées à la culture du service, Arnaud Allesant (Directeur Associé chez Eurogroup Consulting) et Jean-Baptiste Suquet (Enseignant-chercheur à NEOMA Business School) y confrontent leurs perspectives pour explorer les leviers concrets permettant de développer une véritable culture de service au sein des organisations, qu’elles soient publiques ou privées.
NOTRE EXPERT

Arnaud ALLESANT
Directeur Associé