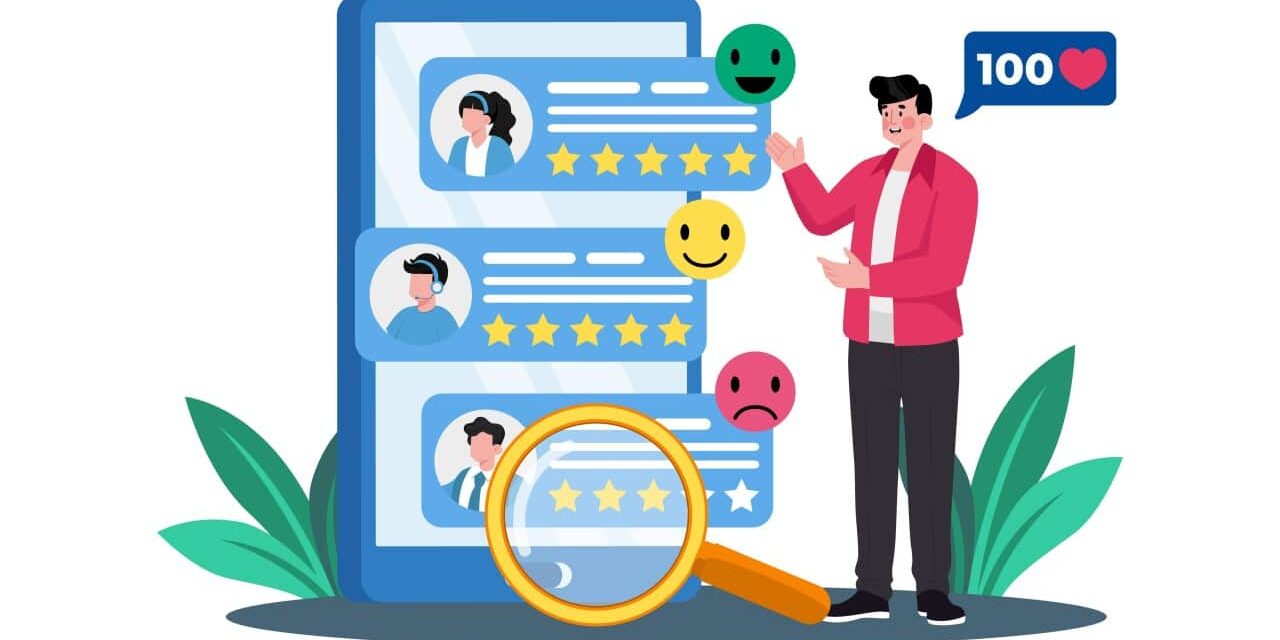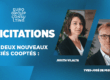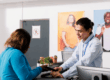Sur le papier et en pratique, les organisations disposent de nombreux indicateurs pour évaluer la performance de leur Expérience Client.
Depuis des années, le débat est nourri pour identifier le méta indicateur : celui qui rend compte de l’expérience vécue de la manière la plus juste et la plus complète. Dans cette perspective, Fred Reichheld avait en 2003 proposé le NPS (« The one number you need to grow » – HBR, 2003), avant que William Dixon ne tente d’imposer le CES (Customer Effort Score) comme alternative (« Stop trying to delight your customers” – HBR, 2010).
Si nous n’avons pas la prétention de faire du taux de réitération le successeur du NPS ou du CES, nous souhaitons toutefois attirer l’attention sur ses vertus.
À l’usage, il se révèle extrêmement puissant pour rendre compte de l’expérience vécue, tout en étant méconnu et clairement sous-exploité dans bon nombre d’organisations, publiques comme privées.
Qu’est-ce que le taux de réitération client ?
Le taux de réitération correspond au pourcentage de clients qui contactent plusieurs fois une organisation pour le même motif, dans un délai donné. On mesure généralement la réitération à 7, 15 ou 30 jours après un premier échange.
Exemple : si sur 1 000 contacts entrants dans une semaine, 150 proviennent de clients ayant déjà contacté le service dans les 7 jours précédents pour le même sujet, alors le taux de réitération à 7 jours est de 15 %.
Pour retranscrire la réelle expérience vécue par le client, l’indicateur doit être évalué dans une approche omnicanale (téléphone, email, chat, formulaires,etc.)
Pourquoi cet indicateur est-il si intéressant ?
1. Il rend compte de relations client réellement à risque
Lorsqu’un client fait l’effort de recontacter une entreprise sur le même motif, c’est le plus souvent, parce que la réponse initiale n’a pas permis de résoudre son problème. Il ne s’agit donc pas d’un simple détail agaçant, mais d’une rupture de fluidité dans le parcours client.
Ce type de situation laisse une empreinte forte. Qui ne s’est jamais dit : « J’ai déjà appelé, et rien n’a bougé » ? Et ce ressenti a un impact direct sur la satisfaction, l’image de marque… voire la fidélité.
2. Il permet d’identifier les causes de la mauvaise expérience
Couplé à une analyse des causes racines, le taux de réitération devient un outil de compréhension des dysfonctionnements sur l’ensemble du parcours client, depuis l’émergence du besoin jusqu’au point de rupture. Les raisons peuvent être nombreuses et riches d’enseignements :
- Le client n’a pas réussi à joindre le service client lors de sa première sollicitation
- Les réponses apportées sont incomplètes ou trop techniques : le client n’a pas compris la solution
- La réponse a été trop rapide, sans personnalisation ou sans empathie – le client n’a pas été rassuré
- La solution apportée n’a pas fonctionné / n’est pas pertinente
- Le client a été routé vers un canal / une solution qu’il n’accepte pas
- Les processus métiers sont défaillants…
Ce type d’analyses permet d’adopter une logique qualitative, au-delà des chiffres et d’alimenter une dynamique salutaire d’animation continue.
3. Il révèle la non-qualité… et son coût
Par définition, chaque réitération (ou presque) n’a pas lieu d’être. Elle représente un coût opérationnel à éviter. Soit l’entreprise n’a pas su résoudre efficacement le problème, soit elle a mal orienté le client vers un canal inadapté.
Un mauvais traitement initial peut générer plusieurs appels, relances ou mails. En mesurant ce taux, on chiffre concrètement la non-qualité et on peut ainsi identifier des leviers d’économies tout en assurant la satisfaction client : automatiser ce qui peut l’être, rediriger intelligemment, ou améliorer les compétences de traitement.
4. Il est objectif, factuel et contribue à la culture client
Contrairement à des indicateurs déclaratifs (NPS, CSAT), le taux de réitération est entièrement fondé sur des faits. Il mesure une réaction comportementale réelle du client, et non un ressenti.
« Par cette caractéristique, le taux de réitération est le meilleur allié de ceux qui en interne se heurtent à des collaborateurs ou managers qui remettent en cause la pertinence de la Voix du Client. »
Qui parmi vous n’a jamais entendu, lors de présentation de résultats d’enquête de satisfaction client dans l’organisation : « mais ce que dit le client, c’est la vérité ? » ou « En France, on sait bien que seuls les clients insatisfaits s’expriment ».
5. Il est facile à communiquer
Le taux de réitération est facile à expliquer, à visualiser et à partager.
« Il peut être utilisé dans les comités qualité, les formations ou les points équipes. Il rend concrets les irritants, tout en valorisant les réussites. »
Il alimente une culture de la résolution durable plutôt que de la gestion à la chaîne.
6. Il révèle la maturité IA de la relation client de l’entreprise
L’essor de l’intelligence artificielle et des bots conversationnels bouscule la lecture du taux de réitération.
D’un côté, les bots permettent de désengorger les canaux traditionnels en traitant automatiquement des demandes simples et répétitives (FAQ, suivi de commande, modification d’informations personnelles…). Mais de l’autre, ils peuvent générer des réitérations en cascade si leur réponse est incomplète, mal comprise ou hors sujet – le client est alors désemparé, dans une boucle d’insatisfaction.
Suivre le taux de réitération post bot est ainsi une opportunité pour évaluer la maturité IA de la relation client et entraîner efficacement le bot pour apporter de la valeur aux clients.
Un indicateur au service de la construction d’une véritable satisfaction client
Le taux de réitération n’est pas qu’un chiffre. C’est un thermomètre de la satisfaction silencieuse – celle qui ne s’exprime pas dans les enquêtes, mais qui se traduit par des comportements concrets.
Un client qui réitère, c’est un client en attente, déçu ou inquiet. Le suivre, c’est passer d’une logique de réparation à une logique de prévention. C’est mesurer non pas seulement la vitesse ou la courtoisie, mais la capacité réelle à résoudre un problème dès le premier contact.
En somme, intégrer le taux de réitération dans vos indicateurs, c’est faire un pas de plus vers une expérience client plus durable. Et vous, qu’en pensez-vous ?
Pourquoi est-il peu utilisé ?
Malgré tous ces atouts, le taux de réitération n’est pas systématiquement intégré dans les tableaux de bord de pilotage. Plusieurs freins peuvent l’expliquer :
- Faible notoriété de l’indicateur : en comparaison de la CSAT, du NPS voire du CES
- Complexité de la mesure : elle exige un SI fiable, des identifiants clients uniques, et un bon paramétrage des motifs de contact
- Vision omnicanale lacunaire : l’intégration entre les SI canaux est rarement complète et les solutions de pilotage sont souvent silotées
- Difficultés d’interprétation : en lien avec le délai à prendre en considération pour définir une réitération, l’existence de réitérations « normales » (ex : un client qui rappelle pour souscrire parce qu’il souhaitait faire un tour du marché…
Quels sont les seuils de performance ?
Les niveaux de performance varient selon les secteurs, les canaux et la complexité des demandes. A 7 jours, on peut considérer qu’un taux inférieur à 10%, à fortiori à 5% est une bonne voire une très bonne performance. A l’inverse, un taux supérieur à 15% doit interroger les décideurs.
Dans des secteurs à forte complexité (santé, énergie, assurance), un taux plus élevé peut être acceptable. Dans des contextes plus simples (e-commerce, retail), l’exigence doit être plus élevée et les seuils abaissés.
NOTRE EXPERT

Arnaud ALLESANT
Directeur Associé