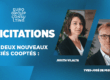Depuis des décennies, l’expression « le Client est Roi » s’est imposée comme un mantra dans le monde de l’entreprise. Elle traduit une vision dans laquelle l’entreprise place le client au sommet de la hiérarchie décisionnelle, adaptant ses produits, ses services à ses moindres désirs. Cette approche, issue du marketing de masse et renforcée par la concurrence accrue dans un monde globalisé, a charpenté la culture client de nombreuses organisations.
A l’heure de l’explosion des plateformes d’avis, de la montée des exigences, et parfois de comportements abusifs, cette maxime montre ses limites. Elle soulève désormais des incompréhensions, des tensions internes, voire des dérives managériales.
Et si, paradoxalement, le mythe du « Client Roi » n’affaiblissait-il pas plus la culture client qu’il ne la développait ? Il est temps de questionner cette croyance pour penser une relation client-entreprise plus équilibrée, plus humaine, plus durable et in fine… plus performante.
Origines et vertus de l’expression
C’est surtout dans le monde anglo-saxon et dans l’univers de la distribution que ce concept s’est théorisé et popularisé. On attribue souvent la paternité de la formule « The customer is always right » à Harry Gordon Selfridge, fondateur des grands magasins Selfridges à Londres au début du XXème siècle ou à Marshall Field, homme d’affaires américain, fondateur des célèbres magasins du même nom à Chicago.
Ces pionniers de la distribution ont mis en place une politique commerciale novatrice pour l’époque : donner toujours raison au client pour gagner sa fidélité, même si cela impliquait des pertes ponctuelles ou des retours injustifiés.
« Right or wrong, the customer is always right. » — Harry Gordon Selfridge (vers 1909)
Le postulat est simple (et validé pour grande partie par la recherche académique) : satisfaire le client est la clé de la réussite. Dans un marché concurrentiel, celui qui offre le meilleur service, la meilleure écoute, la meilleure expérience, gagne.
On notera que l’expression « Client Roi », très utilisée en France, a un ton plus monarchique et symbolique. Cette expression, dénote-t-elle un héritage culturel ? Elle renforce l’idée, en tout cas, que l’entreprise est au service du client, et non l’inverse. La figure royale évoquant l’obéissance, la révérence, et l’idée d’un pouvoir suprême exercé par le consommateur.
L’expression a forgé l’orientation client de nombreux individus, son évidence brute constituant sa force. Comme les collaborateurs eux-mêmes nous le rappellent lors de diagnostics ou de travaux de recherche en culture client : « c’est le client qui (les) fait vivre ». En ce sens, ils soulignent bien souvent une préoccupation forte de leur management ou de leur organisation pour :
- la rentabilité à court terme
- la technique
- les contraintes internes
- les 3 à la fois
Les limites de l’expression : pression, abus et déséquilibres
Si placer le client au centre est légitime, cela peut conduire à des dérives notables. La première victime de cette logique est souvent… le salarié.
1. Des salariés sous pression
Dans les métiers du service, la culture du Client Roi a pu se traduire par une pression constante sur les employés : faire plaisir, éviter le conflit, répondre rapidement, être disponible, gérer les mécontentements, parfois l’agressivité, tout en gardant le sourire. Cette pression engendre stress, fatigue émotionnelle et sentiment d’injustice.
On observe un glissement : le client devient un juge permanent, souvent armé d’une plateforme de notation ou d’avis en ligne. Les erreurs ou maladresses sont immédiatement rendues publiques. Le salarié est exposé, surveillé, évalué. Et ce pouvoir peut être mal utilisé.
2. Des comportements clients parfois abusifs
Le mythe du Client Roi a par ailleurs pu favoriser des comportements clients inappropriés, voire abusifs. Certains clients se sentent légitimes à tout exiger, à se montrer impolis, voire violents verbalement, au nom de leur statut de consommateur.
On assiste parfois à des scènes où l’agressivité du client est tolérée par l’entreprise, qui préfère éviter le conflit et « garder le client ». Ce choix détruit la cohésion interne, démotive les équipes, et abîme la culture d’entreprise.
3. Au final, une perte de culture … client
Cette quête incessante de satisfaction immédiate de tout client peut aussi faire perdre de vue l’essentiel : la mission de l’entreprise, sa cohérence, ses valeurs. Tout ne peut pas être fait « à la demande ». Certaines entreprises s’épuisent à courir après des attentes mouvantes, contradictoires, irréalistes, oubliant parfois leur propre vision.
Cette relation déséquilibrée et douloureuse développe la peur des clients et le désengagement. Elle épuise littéralement l’orientation client des individus, détruisant in fine la véritable culture client, à savoir la capacité à écouter et décrypter le client pour éclairer les choix et les décisions de l’entreprise
Enfin, il est probable que la notion de Client Roi, comme ingrédient constitutif de l’orientation de service, agisse comme inhibiteur voire repoussoir culturel pour certains agents d’environnements publics ou parapublics.
Vers une relation enrichie
Face à ces constats, le rapport au client doit être repensé. Il ne s’agit plus de le vénérer comme un roi, mais de l’inviter à devenir un partenaire. Ce changement de posture suppose plusieurs évolutions.
1. Protéger et revaloriser le rôle du salarié
Le salarié n’est pas un simple exécutant. Il est porteur de l’expérience client. Une entreprise qui valorise son personnel, lui donne de l’autonomie, le protège face aux comportements toxiques, renforce en réalité la qualité du service. Car un salarié écouté, respecté et épanoui sera plus à même d’écouter le client à son tour.
Un dirigeant nous rapportait récemment qu’il n’obligeait plus ses collaborateurs à recontacter un client insatisfait qui s’était montré particulièrement virulent. Il leur laissait le choix. Ce geste nous semble approprié : rappeler le sens et l’intérêt d’un contact client, poser les limites pour protéger son équipe et laisser la décision et l’exécution à son collaborateur.
2. Encadrer la relation client
Déconstruire le mythe du client Roi, ce n’est pas mépriser le client, mais poser les règles de la relation. De la même façon qu’un client a des droits, il a aussi des devoirs. Il est possible de refuser un comportement irrespectueux, d’éduquer à la courtoisie, d’imposer une éthique relationnelle.
Certains acteurs du e-commerce ou de la restauration ont instauré des chartes de respect mutuel, voire des blacklists de clients abusifs. Un acte fort, mais salutaire pour restaurer une relation saine.Nous connaissons tous également l’exemple d’UBER , où le comportement client est évalué à chaque course par le chauffeur
Il est possible et souhaitable de défendre l’expertise du personnel en contact ou de l’organisation (en mobilisant un expert) dans le cas de service à base technique forte (produits artisanaux, produits technologiques). Un client peut ainsi penser (sincèrement) bien comprendre le problème technique de sa voiture suite à sa consultation de forums en ligne – mais il est fort probable que le personnel en contact soit plus légitime à formuler un diagnostic !
3. Co-construire avec le client
Enfin le client est un co-créateur potentiel. De nombreuses marques s’engagent aujourd’hui dans la co-conception : elles impliquent leurs clients dans le développement de produits, dans les retours d’expérience, dans l’amélioration continue. Cette démarche transforme la relation : on passe de la satisfaction passive à l’implication active. Le client devient acteur d’un projet commun.
4. Equilibrer les contraintes
Le mythe du Client Roi montre ses limites dans la construction d’une culture client forte. Déconstruire ce mythe ne signifie pas abandonner le client, mais repenser la relation de manière plus juste, plus respectueuse, plus humaine et finalement plus orientée client.
NOS EXPERTS

Arnaud ALLESANT
Directeur Associé